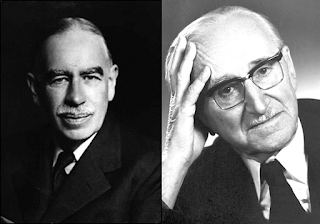Stephen Roach a récemment publié une tribune dans laquelle il s’inquiète des politiques monétaires menées par les banques centrales. Selon lui, ces dernières accordent trop d’importance au pilotage des taux d’inflation et ce faisant négligent les risques d’instabilité financière. Il constate qu’au cours des années 2000, les faibles taux d’inflation ont été concomitants de bulles financières massives dans plusieurs pays développés.
Cette ligne argumentative le conduit à préconiser une normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis le plus vite possible. On ne peut que partager les inquiétudes de l’auteur sur les risques d’instabilité financière. Par contre, on peut s’étonner du refus d’analyser les causes réelles derrière la multiplication des bulles financières ces dernières décennies. Elles tiennent surtout à deux causes évidentes et lourdement établies : la dérèglementation et la liberté de circulation des capitaux.
On peut même comparer l’histoire récente de la finance mondiale à un bateau qui tangue de plus en plus fortement sous les flux et reflux des mouvements de capitaux. On propose ici un rapide rappel historique (et sans vouloir être exhaustif):
Le coup d’envoi de la dérégulation fut donné en 1980 et s'accéléra après que Paul Volcker eut spectaculairement augmenté les taux d’intérêts pour « mater » l’inflation aux Etats-Unis. Il s’en suivit une guerre cruelle entre les différentes institutions financières américaines pour retenir l’argent des épargnants et des investisseurs.
Des acteurs comme les Saving & Loans n’ayant pas le droit de rémunérer leurs dépôts au-delà de certaines limites, le gouvernement américain décida de déréguler le marché pour leur permettre de combattre à armes égales. Les résultats ne se firent pas attendre. En encourageant une concurrence de plus en plus féroce, le gouvernement encouragea les institutions financières à une prise de risque sans cesse accrue pour proposer les meilleurs rendements. Cela se termina par la gigantesque débacle des Saving & Loans.
Fières de ces brillants débuts, les institutions internationales encouragèrent les pays émergents à déréguler et ouvrir leur secteur bancaire au capitaux internationaux. Une nouvelle fois les résultats furent au rendez-vous avec la crise asiatique de 1997 suivie de peu par les crises russes et brésiliennes de 98 et 99. Le rapatriement massif de capitaux vers les pays développés qui s’en suivit tomba juste à point pour alimenter le brasier de la bulle des nouvelles technologies qui explosa si spectaculairement pour fêter le nouveau millénaire.
Bien sur, le clou du spectacle était encore à venir avec les judicieuses innovations financières des années 2000 qui permirent à la finance américaine de refourguer des prêts pourris au quatre coins de la planète dans l’opacité la plus totale. Ce phénomène fut d’ailleurs aggravé par l’obsession pour l’accumulation de réserves de devises des pays asiatiques qui, échaudés par les humiliations et les avanies infligées par les institutions internationales à la suite de la crise de 97, se jurèrent de ne jamais se retrouver dans la même situation. L’économie mondiale s’en trouva durablement déséquilibrée.
Alors, plutôt que de proposer de jeter des seaux d’eau glacée à un malade brulant de fièvre, ne serait-il pas plus utile de traiter les causes profondes du problème avec les médicaments appropriés ? En n’hésitant pas à froisser quelques intérêts bien entendu…